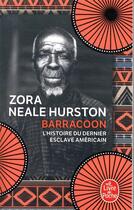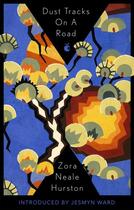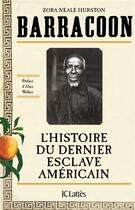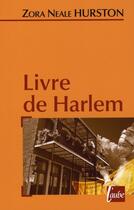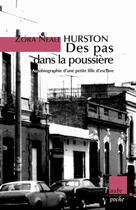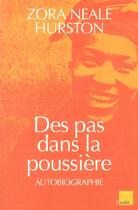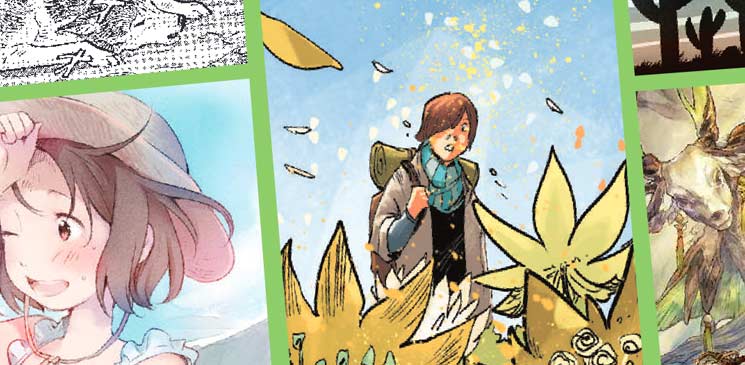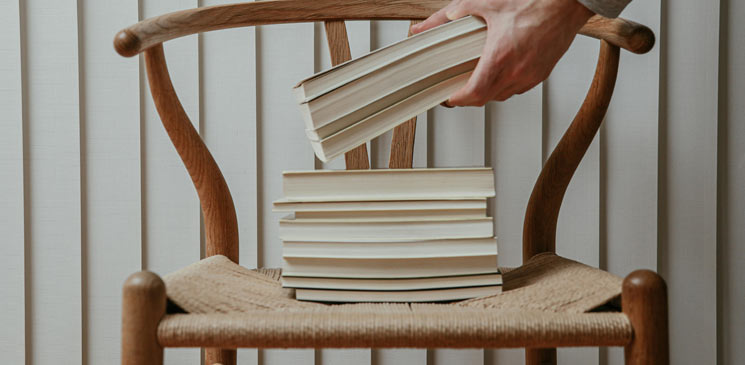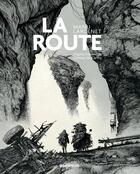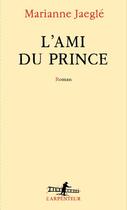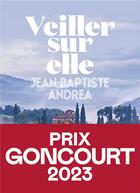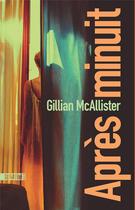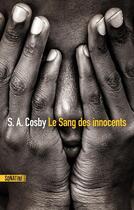Their Eyes Watching God, fut écrit par une écrivaine afro-américaine, en 1937. Et le récit se situe dans la Floride du début du XXe siècle, région où sévit toujours le racisme.
Janie Crawford, raconte à sa meilleure amie, Pheoby Watson, les principales étapes de sa vie de femme noire. Et...
Voir plus
Their Eyes Watching God, fut écrit par une écrivaine afro-américaine, en 1937. Et le récit se situe dans la Floride du début du XXe siècle, région où sévit toujours le racisme.
Janie Crawford, raconte à sa meilleure amie, Pheoby Watson, les principales étapes de sa vie de femme noire. Et surtout, une fois découvert sa couleur de peau, une recherche permanente sur différents points, notamment : de sa liberté de vivre comme elle le souhaite, d’être en communion avec sa communauté, de découvrir le monde, de parfaire sa soif d’apprendre, bref, d’être tout simplement heureuse !
Elle va pour ce faire, se marier plusieurs fois, et passé les premiers instants, elle s’aperçoit que son existence consiste surtout à rester passive dans les relations de couple. Etre en permanence corvéable à merci ! Alors dans ces dispositions comment connaître le véritable amour ; la transcendante du couple dans ces conditions ?
Seul son troisième mariage avec Virgible Woods - Tea Cake – lui apportera, enfin, une lumière dans sa vie. Une vie sortie qui la sortira de l’immobilisme, de l’inénarrable solitude qu’elle a déjà connue et redoute toujours. Enfin l’ivresse pour elle de la découverte d’un amour partagé, de faire fi des convenances. Mais les moments joyeux ont aussi leurs périodes de malheur ! Mais chut, laissons le lecteur découvrir les vicissitudes de l’existence…
Un voyage dans l’univers d’une littérature noire – Tous enlaidis par l’ignorance, brisés par la pauvreté -, avec peu d’interventions de la population blanche, let une sempiternelle apparition du racisme sous-jacent entre les membres de cette communauté.
Un récit poignant, certes, mais difficile d’approche, par l’utilisation d’une retranscription phonétique du dialecte des noirs d’origine africaine. Il faut « s’accrocher » pour en pénétrer l’âme de Janie et ressentir ainsi tous ses émois. Un rare moment de tristesse mais aussi d’espoir pour savourer – la floraison d’un poirier au printemps -.