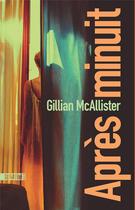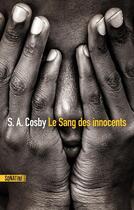Résumé:
Le philosophe italien Pierandrea Amato s'interroge sur le sens des images de la prison d'Abou Ghraib, dix ans après que leur diffusion a mis en émoi l'opinion publique mondiale et qu'elle a entraîné la condamnation des soldats responsables à dix ans de réclusion pour actes de torture. La... Voir plus
Le philosophe italien Pierandrea Amato s'interroge sur le sens des images de la prison d'Abou Ghraib, dix ans après que leur diffusion a mis en émoi l'opinion publique mondiale et qu'elle a entraîné la condamnation des soldats responsables à dix ans de réclusion pour actes de torture. La démarche de l'auteur est ici de s'affranchir du pathos que suscitèrent ces clichés et de faire glisser le regard de la constatation (éthique, politique ou morale) vers l'herméneutique pour éclairer notre époque et son rapport à l'image :
« Je le dis sans détour : mon intention n'est pas de m'intéresser à ce genre de problème, en relation avec les événéments d'Abou Ghraib. Non pas que ce genre de sujet ne soit d'aucune importance sur la «scène du crime». Ces perspectives ont été amplement exploitées et je ne crois pas nécessaire d'y insister à mon tour et de raisonner à nouveau sur la valeur de ces photos, à partir de considérations qui ne concernent pas le pur donné visible auquel nous sommes confrontés. Il est plus difficile, mais aussi plus important, dix ans après, de chercher à identifier ce qui survit dans cette effroyable série d'images, qu'on était alors incapables de voir, et qui n'a pas été purement et simplement enfoui dans le passé. En fait, je dirais que c'est aujourd'hui que les clichés d'Abou Ghraib ont atteint le stade de leur pleine déchiffrabilité, car pour reprendre une idée de Walter Benjamin, c'est maintenant qu'ils nous donnent la possibilité de reconnaître en eux ce qu'ils sont réellement : un document de notre brutalité ordinaire et banale (esthétique), comme indice fondamental de la guerre contemporaine menée au nom des valeurs démocratiques. » L'image confère un ordre à ce qui est ambiguë, illisible et qui se produit sous nos yeux. Lire l'image et la comprendre deviennent alors autant de moyens d'agir (Marx : « la situation catastrophique de la société dans laquelle je vis me remplis d'optimisme »).
Amato voit dans ces clichés de véritables oeuvres esthétiques qui, bien qu'elles n'aient rien d'artistique, provoquent une perturbation. Il replace ces clichés dans la continuité (bien involontaire) de la révolution esthétique entreprise en Amérique depuis cinquante ans : le « non art » (« forme d'art » contre l'asservissement de l'expression), qui lui-même prolonge l'ambition de Duchamp de rapprocher l'art du quotidien. Ces clichés sont extraordinaires en cela qu'ils dégagent un sentiment de banalité totale et d'ordinaire (cf. le sourire des bourreaux devant la pile de corps des prisonniers Irakiens).
« Dans le comportement des soldats se condense la signification précédemment évoquée d'une série de photographies de guerre incarnant le nouvel ordre post-esthétique dans lequel nous sommes quotidiennement immergés. » La force de ces clichés réside dans les sourires, dans la « pose » convenue de chacun de ses figurants, comparable à celle de touristes posant devant la tour de Pise. La pose est identique, qu'elle se produise devant une oeuvre d'art ou la manifestation de la plus grande barbarie - devant ce que l'auteur appelle, pour résumer, « le culte spectaculaire d'une condition générale de la culture occidentale : la quotidienneté monstrueuse ». De par leur posture, les acteurs créent un climat qu'ils veulent apaisé, presque familial. Ils communiquent l'idée selon laquelle cette guerre est absolument ordinaire et qu'il n'y aurait absolument pas de crainte à avoir de l'Autre (ici, l'ennemi, l'Irakien). Reprenant la théorie de Genet selon laquellel'image a deux fonctions (montrer et dissimuler), cette série d'images est une projection de notre quotidien :
Une incroyable combinaison entre le monstrueux et la routine la plus banale. « L'apocalypse du réel s'est accomplie, si bien que l'horreur s'est incorporée en devenant ainsi, à bien y regarder, toujours plus tolérable ».
Amato prend alors le lecteur à témoin. Concentrant son regard sur le sourire hilare de tel ou tel soldat devant l'horreur d'une telle scène, il fait siennes les analyses de Giorgio Vasta sur l'excès d'hilarité dans nos sociétés qui traduit une tragique distanciation avec le réel et une véritable impuissance face à lui (« no alternative »). Le sourire brouille la condition dans laquelle nous nous trouvons déplaçant le choc (de l'image, du réel) vers une posture standard/familière.
L'image participe à la construction du réel. Amato se risque à un parallèle historique avec la période nazie. Selon la grande majorité des historiens, la destruction d'oeuvres d'art identifiées comme « dégénérées » annonçait le massacre de ceux qui « n'étaient pas dignes de vivre ». De même, ici, la condition des prisonniers d'Abou Ghrabir est « mise en scène » de manière à donner sens au réel, à le rendre spectaculaire et à lui donner la dimension d'un événement.
L'événement/spectacle caractérise notre rapport au réel et tout ce qui ne l'est pas n'est pas digne d'être vécu.
Or pour devenir spectaculaires, pour faire événement, les faits doivent devenir des images (icônes) et donc être photographiés. Cette image, au-delà de toute considération morale, est donc également normative, puisqu'elle donne une valeur à la guerre. La guerre est ici une chose qui vaut la peine d'être vécue (puisqu'elle mérite d'être photographiée).
Nous ne sommes donc pas seulement en présence de trois imbéciles qui, par excès ou par vice se seraient employés à torturer des prisonniers de guerre, mais bien en face de l'excès et de la monstruosité du quotidien partagé par chacun d'entre nous : « leur sourire est du même ordre que notre complaisance devant la machine qui nous prend en photo devant un monument ou quoi que ce soit d'autre ». Et l'auteur de conclure avec iek que ces clichés matérialisent la nature à la fois aimable et brutale de la démocratie libérale ; le côté obscur de la culture populaire américaine (et on ajouterait globale). C'est le propre même de la performance artistique.
Des clichés sont reproduits dans le livre, accompagnés de dessins de l'artiste Susan Crile. Ces dessins reproduisent à l'identique les clichés tout en masquant la silhouette du geôlier. Il ne subsiste plus qu'une main qui pourrait être la nôtre : car « les soldats, au fond, ont fait ce qu'ils ont fait pour nous ».
L'auteur conclut en affirmant qu'Abou Ghraib est également le nom de l'unique figure de l'altérité que notre culture réussit à tolérer : celle de l'Autre soumis.
La figure de l'Autre dans cette prison est le fait d'un rituel qui servirait à consolider nos propres valeurs. Les clichés d'Abou Ghraib mettent en lumière la dialectique grotesque et sadique dont témoignent nos sociétés.
« Les clichés d'Abou Ghraib font écho à une autre attitude essentielle de la photographie : la capacité de mentir sans pourtant trahir son sujet. Ainsi le sourire du soldat est-il vrai et faux en même temps. Vrai en ce que, effectivement, la photographie enregistre son visage insouciant. Faux, parce que son hilarité creuse la distance d'une scène qui ne fait clairement pas rire.
Et cependant, nous savons bien ¬- même si cela nous remplit d'amertume -, comme le montre le premier roman de Giorgio Vasta (Il tempo materiale), que l'excès d'hilarité, d'ironie ou de comique qui domine nos réunions, nos relations, nos scènes entre amis, notre vie, toutes les occasions ou l'on rit pratiquement sans relâche, est le signe d'un désespoir qui vise à éluder l'humiliation dont nous sommes actuellement la proie, le fait de n'avoir personne d'autre à nous occuper que de nous-mêmes.
La séquence vague et indistincte de rire qui tend à tronquer et à empêcher tout discours (un rire qui ne se transforme que très rarement, comme cela me plaiarait davantage, en une énergie rabelaisienne, dramatique, profanatrice), en ce temps de fin où l'on n'a « jamais fini d'en finir », cache probablement distance subtile et courageuse à l'égard du monde. Elle dit ainsi, très simplement mais avec la même sincérité, l'exigence de sa transformation, sans aucune crainte ni trêve. ».