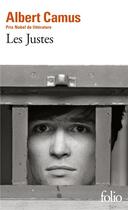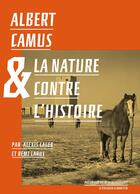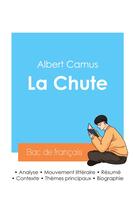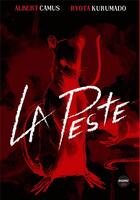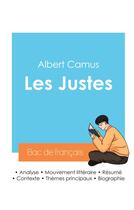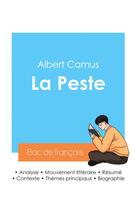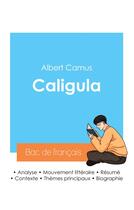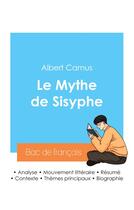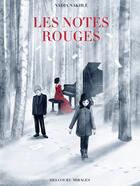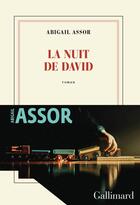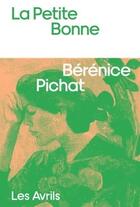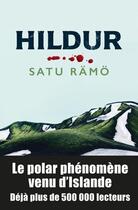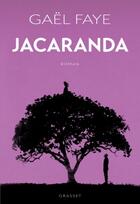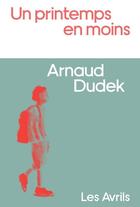Difficile de faire un bref résumé de cet ouvrage. Juste en dire que son auteur a voulu définir avec précision et objectivité la notion de « révolte », à ne surtout pas confondre avec « révolution » qui signifie réalisation, cristallisation d’une révolte. De tous temps, la condition de l’homme...
Voir plus
Difficile de faire un bref résumé de cet ouvrage. Juste en dire que son auteur a voulu définir avec précision et objectivité la notion de « révolte », à ne surtout pas confondre avec « révolution » qui signifie réalisation, cristallisation d’une révolte. De tous temps, la condition de l’homme lui a semblé difficile, voire insupportable, en dépit des consolations de la religion qui donnait l’espoir d’un sort meilleur dans l’autre monde. Depuis la contestation du protestantisme, puis l’avènement des philosophes des « lumières », puis l’explosion de la révolution et la décapitation du roi Louis XVI, la divinité est morte. L’homme s’est retrouvé seul face à son destin. « Si Dieu est mort, tout est possible », a écrit Dostoïevski. La religion a tourné en politique, la révolte en principe intangible et le bonheur sur terre a été reporté aux calendes grecques, c’est-à-dire à l’avènement du socialisme intégral, du communisme idéal, etc. Pour atteindre cet idéal inaccessible, tout opposant, toute personne supposée hésitante devient alors immédiatement suspecte, donc emprisonnée, jugée sommairement et guillotinée sous la Terreur en France, envoyée au Goulag dans l’URSS de Lénine et Staline, au Lao-Gai de Mao ou en camp de concentration sous Hitler. « La vertu absolue est impossible. La république du pardon amène par une logique implacable la république des guillotines », note d’ailleurs Camus.
« L’homme révolté » est un essai de philosophie politique de très haut niveau et pourtant relativement facile à lire car l’auteur présente les faits avec une grande clarté et une certaine simplicité, mais sans tomber dans la vulgarisation. Il en appelle à de nombreux exemples, autant de l’histoire ancienne que récente. Ainsi présente-t-il le marquis de Sade comme le premier théoricien de la révolte absolue. « Dans les chaînes, l’intelligence perd en lucidité ce qu’elle gagne en fureur. Sade n’a qu’une logique, celle des sentiments », écrit-il. Après ce précurseur, Camus en appelle à de nombreux autres comme Saint-Just, Dostoïevski, Nietzsche, Bakounine, Marx ou Hegel, pour ne citer que les principaux. Avec Lautréamont, Breton et quelques autres, il en vient même à la révolte des écrivains, des poètes, des musiciens ou des peintres dans un chapitre sur l’art contemporain (comptant pour rien), peut-être le summum de l’ouvrage. Datant de la moitié de l’autre siècle (1951), cet essai est donc tributaire de l’actualité politique de son époque avec une URSS menaçante et des Etats-Unis encore sur la défensive. Mais le discours reste exact et semble même presque optimiste aujourd’hui. Qu’aurait dit Camus s’il avait pu analyser l’incroyable fusion du capitalisme avec le communisme et le nazisme dont nous sommes aujourd’hui témoins et victimes ? Ce néo-totalitarisme soft et hyper technologique lui aurait-il même permis de pousser ce cri qu’il faut absolument lire ou relire pour mieux comprendre la problématique de la révolte ?