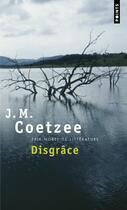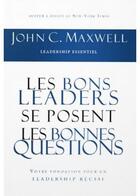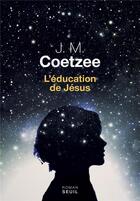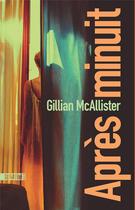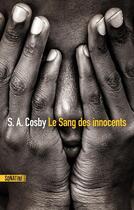J’aime beaucoup les arcs-en-ciel, ce qui n’a rien d’original, n’est-ce-pas ? C’est l’instant magique où une lumière céleste triomphe du mauvais temps qui l’a précédée. On a tous envie de figer cela dans une photographie parce qu’on sait que ça ne durera pas. C’est magique comme ce 24 juin 1995,...
Voir plus
J’aime beaucoup les arcs-en-ciel, ce qui n’a rien d’original, n’est-ce-pas ? C’est l’instant magique où une lumière céleste triomphe du mauvais temps qui l’a précédée. On a tous envie de figer cela dans une photographie parce qu’on sait que ça ne durera pas. C’est magique comme ce 24 juin 1995, où à Johannesburg, Nelson Mandela, revêtu du maillot Springbok, remet, dans la liesse générale, la Coupe du monde de rugby à quinze de ses compatriotes blancs (quatorze) et noir (un). Le monde entier découvre alors avec ravissement que les plus longues et terribles tragédies peuvent parfois se terminer en conte de Noël. La nation Arc-en-ciel, inventée par Desmond Tutu, est révélée au monde ce jour-là. Johnny Clegg, le « zoulou blanc » (Asimbonanga, vous vous souvenez ?) et ses musiciens de Savuka font chanter le stade, danser la planète tandis que les dingues de rugby détournent le regard pour essuyer une larme.
Disgrâce date de 1999, la lumière s’est éteinte, Mandela commence à s’effacer, les lourds nuages noirs sont de retour, l’arc-en-ciel n’est plus qu’un souvenir et la nation éponyme voit ses différentes couleurs se séparer à nouveau pour recommencer à se déchirer.
Dans un style froid, sec, distancié qui convient parfaitement au propos, le narrateur nous décrit la rapide descente aux enfers de cet enseignant vieillissant spécialiste de poésie romantique qui ne se résignait pas à renoncer au désir. Il y a bien l’amour tarifé mais si une jeune et jolie étudiante se laissait faire, ce serait tellement mieux… « Elle ne résiste pas. Elle se contente de se détourner. Elle détourne les lèvres, elle détourne les yeux. Elle le laisse l’étendre sur le lit et la déshabiller : elle lui vient même en aide en soulevant les bras et les hanches… Ce n’est pas un viol, pas tout à fait, mais sans désir, sans le moindre désir au plus profond de son être. Comme si elle avait décidé de n’être qu’une chiffe, de faire la morte au fin fond d’elle-même le temps que cela dure, comme un lapin lorsque les mâchoires du renard se referment sur son col. »
C’est mal parti et ça va mal finir. Il y a la civilisation, ses collègues de l’université qui examinent la plainte de l’étudiante, qui condamnent avec formalisme et méthode le plaisir passé d’âge qu’elle avait pourtant laissé passer. Passé un certain âge, un âge certain plutôt, que reste-t-il à celui que les femmes plus jeunes attirent encore ? Offrir de l’argent ou de l’influence. Ce n’est pas moral, il en convient mais… « Est-ce que vous regrettez ? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ? Non, dit-il. C’était une expérience enrichissante. » Il avoue, reconnaît son forfait et disparaît. Il se réfugie chez sa fille, dans une ferme isolée, dans un espace où la peur a changé de camp, où les Blancs baissent la tête et rasent les murs comme le faisaient jadis les Noirs. Il y a la manière douce et sournoise du voisin qui étend son domaine et offre sa « protection », et il y a la manière brutale et barbare des trois violeurs. Il s’agit de souiller, de punir, de prendre une revanche. A présent, c’est sa fille qui a subi les derniers outrages (le titre anglais disgrace s’emploie également pour honte, souillure, outrage) et lorsqu’elle fait mine de s’en accommoder, comme le font, partout de par le monde, quelle que soit leur couleur de peau, ceux qui n’ont aucun espoir d’échapper à leurs tourmenteurs, il ne comprend pas, il ne voit pas le parallèle avec l’étudiante qui « avait décidé de n’être qu’une chiffe, de faire la morte ». C’est un roman d’un pessimisme très sombre qui traite des affres de la vieillesse concupiscente, de la solitude et de la violence de la société sud-africaine, à travers les non-dits et les explosions soudaines et brutales de barbarie qui peuvent frapper en totale impunité et à tout moment. Ajoutons-y, pour faire bonne mesure, la souffrance des animaux, innocents entre les innocents dont le sort terrible ne peut être adouci, avant la mort, que par un regard ou un caresse dispensée par celui qui, avant sa chute, ne leur reconnaissait aucun droit, aucune existence et qui, au fond de sa déchéance, dans un monde qui semble retourner à l’âge de fer (la quatrième de couverture qui utilise cette image n’exagère pas), n’a plus qu’eux pour exprimer la tendresse que même sa propre fille refuse. Le roman, qui se termine sur une dernière phrase accablante, est puissant, d’une richesse insoupçonnable au début de la lecture, et marque profondément le lecteur ainsi interpellé sur le monde qui vient et qui risque fort de ressembler peu ou prou à l’ex-nation arc-en-ciel. Ca ne donne pas envie de passer de prochaines vacances en Afrique du Sud mais convainc de poursuivre l’exploration de l’œuvre de J.M Cotzee.
« Il y a dans le désespoir quelque chose qui nous rend incapable d'accepter de l'affection. »
R. Goolrick – Arrive un vagabond.