Découvrez ce livre avec votre ado et chroniquez-le ensemble !
Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous
gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la
communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !
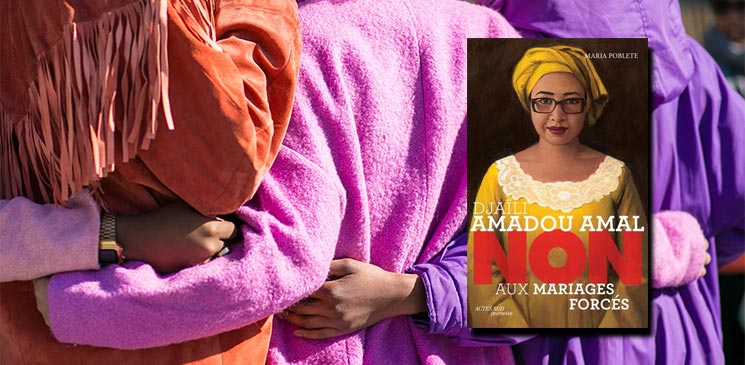
Découvrez ce livre avec votre ado et chroniquez-le ensemble !
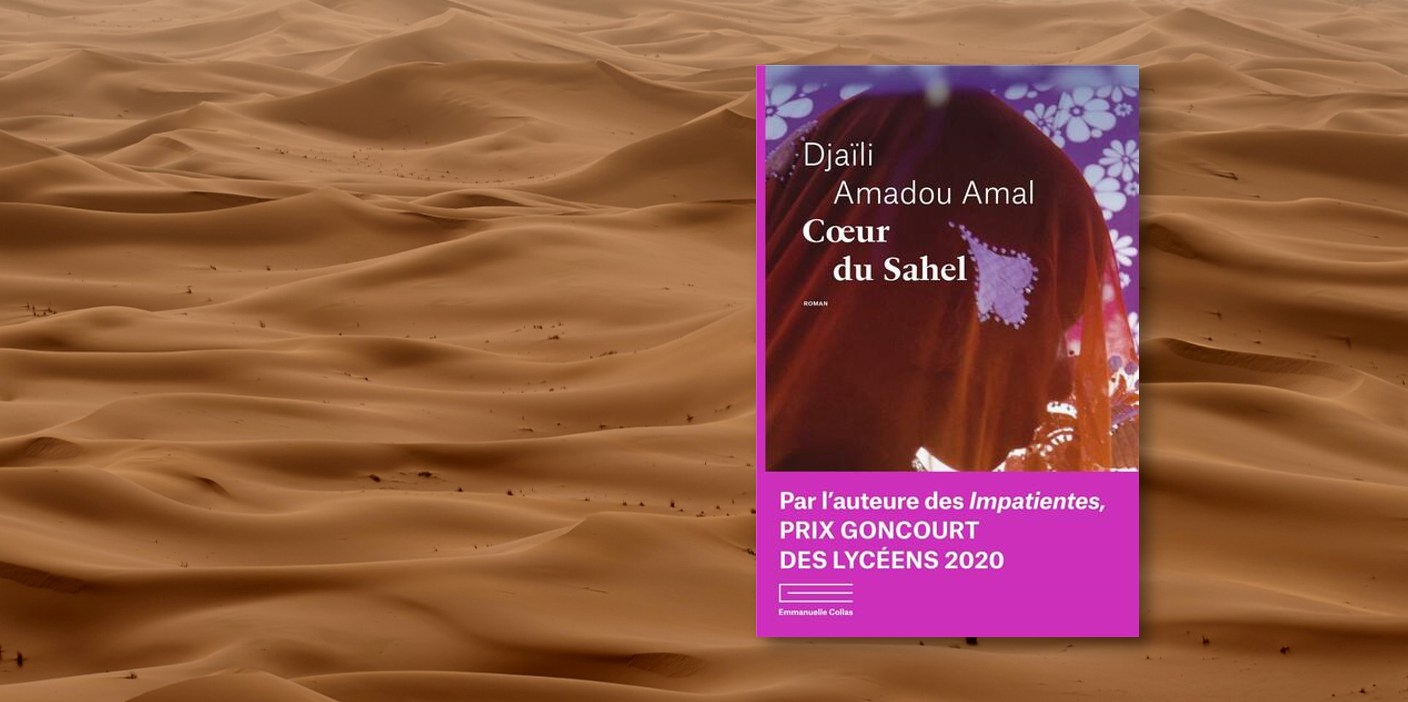
Par la lauréate du Goncourt des Lycéens et du 1er Prix Orange du Livre en Afrique

Du Prix Orange du Livre en Afrique au Prix Goncourt des Lycéens, l'incroyable parcours de la romancière camerounaise

Ces moments d'échange avec les auteurs du moment sont disponibles en replay
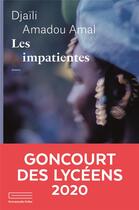
rois voix, celles de Ramla, Hindou, Safira pour dérouler la condition des femmes peules au nord du Cameroun.
Le récit largement inspiré de faits réels a pour nous une valeur documentaire, tel un reportage pour dire ce qu'est l'autorité des hommes qu'ils soient pères, oncles ou maris , pour relater les drames que sont le mariage forcé et le viol conjugal, pour nous montrer ce que la polygamie engendre comme sentiments destructeurs chez les coepouses.Pour échapper à sa destinée, l'on est prêt à toutes les noirceurs et le maraboutage est le recours commun dans une culture où le mot d'ordre donné aux femmes est : « La patience est une vertu » et « respect et considération à vos époux ». La répudiation est une menace constante.
Ramla fait des études , il est prévu qu'elle épouse Aminou étudiantà Tunis,dont elle est amoureuse . Mais son oncle s'oppose finalement à ce mariage . Il lui impose comme mari Alhadji Issa,l'homme le plus important de la ville.
Hindou se marie à son cousin Moubarak, un voyou qui la bat et la trompe. Quand elle fuit de la concession , sa famille ne la soutient pas.
Safira, première épouse de Alhadji Issa, ne supporte pas de partager son mari avec Ramla. Elle devient venimeuse…
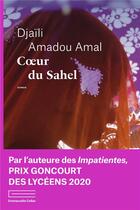
Faydé est une adolescente de 15 ans, elle vit avec sa mère et sa fratrie, au village. Le père a disparu sans que l’on sache si cela était volontaire ou non.
Les conditions sont rudes : les récoltes sont de plus en plus maigres à cause du réchauffement climatique, Boko Haram se rapproche. Faydé rêve d’aller travailler en ville pour mieux s’en sortir.
Malgré les réticences de sa mère, celle-ci finit par accepter et la jeune femme rejoint les autres filles du village qui sont devenues domestiques dans de riches familles.
Faydé va apprendre à se taire, malgré les humiliations et les difficultés, à travailler de longues heures pour un salaire de misère pour aider sa famille…
Ce roman, après « Les impatientes » couronné du Goncourt des lycéens, revient sur la condition féminine au Sahel. L’autrice aborde le sort de ces femmes des régions rurales, pauvres, qui comptent pour si peu, qui ne seront jamais que des « kaado » aux yeux de leurs employeurs.
Djaïli Amadou Amal évoque aussi la discrimination ethnique des habitants de la montagne face aux peuls musulmans des villes, riches. Pourtant eux aussi sont enfermés dans leurs traditions.
Ce roman met en avant le rôle de l’éducation comme moteur d’émancipation des femmes et d’ascension sociale.
Il illustre aussi, même si cela est fait par petites touches, comment la corruption, le pouvoir et l’argent servent à régler des comptes personnels et comment Boko Haram déstabilise toute une région avec ses exactions.
Ce roman reste, malgré les sujets graves abordés, solaire et rend un bel hommage à ces femmes qui malgré les difficultés, n’abandonnent pas.
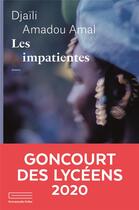
« Patience, mes filles ! Telle est la seule valeur du mariage et de la vie ».
Telle est la litanie que l’on enfonce dans le crâne des jeunes filles sur le point d’être mariées (et pas « sur le point de se marier », nuance), puis des femmes mariées chaque fois que leur mari prend une nouvelle épouse.
Bienvenue dans les riches familles peules et musulmanes du nord du Cameroun, où les femmes, une fois mariées, sont cloîtrées chez elles, bonnes à faire le ménage et des enfants. Dans ce roman qui sent le vécu, trois destins (inéluctablement tragiques) de femmes s’entrecroisent : Ramla, 17 ans, mariée de force à un client de son père, plus âgé et surtout plus riche que le jeune homme qu’elle aimait et qu’elle aurait dû épouser sans cet « arrangement commercial » conclu par son père. Sa cousine Hindou, même âge, est également mariée à un cousin, violent et accro aux drogues et à l’alcool. Quant à Safira, la trentaine, elle doit « accueillir » la deuxième épouse de son mari, qui n’est autre que Ramla.
Chaque partie du roman donne la parole à l’une d’elles, une parole remplie tour à tour de colère, de désespoir, de tristesse, de découragement, de jalousie, de haine. Mais une parole assourdie, presque silencieuse puisque inexprimable, inaudible dans cette société clanique ultra-patriarcale où les femmes n’ont jamais voix au chapitre et sont privées de toute liberté personnelle. Une parole donc vaine et d’autant plus désespérée, que seuls les lecteurs entendront. Une parole lourde et pesante, tant ces femmes subissent des horreurs physiques et psychiques, de la part de leurs maris mais aussi de leur entourage, y compris leur propre mère : viol conjugal, coups, polygamie, violence verbale, dénigrement, chantage affectif, pressions, menaces de répudiation au moindre faux pas, lequel peut en outre se répercuter sur les autres membres vulnérables de la famille (mère âgée, sœurs plus jeunes,…).
La partie consacrée à Ramla décrit la période précédant son mariage et la mécanique perfide mise en œuvre pour la « convaincre » d’épouser l’homme choisi pour elle. Celle centrée sur Hindou raconte le calvaire enduré pendant son mariage, et celle concernant Safira montre les moyens que celle-ci utilise pour se débarrasser à tout prix de Ramla, la nouvelle épouse et rivale, plus jeune et plus belle.
Ce que subissent ces femmes et ces jeunes filles est tout bonnement épouvantable, horrible, à la limite du soutenable. Et au milieu de cet enfer sur Terre, le plus interpellant, le plus consternant, le plus incompréhensible, c’est de voir comment les femmes contribuent largement à perpétuer cette spirale morbide, d’observer comment elles se déchirent, hypocrites et égoïstes, et comment elles écrasent la moindre tentative de rébellion. J’imagine que cette absence de solidarité et de bienveillance est due à l’emprise exercée par la communauté, la tradition, les hommes.
« Les impatientes » (quelle ironie dans ce titre) est un roman qui se dévore (malgré le sujet), grâce à son écriture simple, fluide, percutante, impitoyable, qui met en colère, révolte et désespère.
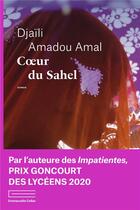
Quelle courage de cette femme ,un livre émouvant mais à cœur de le lire , son parcours est exemplaire malgré sa souffrance ,une femme courageuse
Il n'y a pas encore de discussion sur cet auteur
Soyez le premier à en lancer une !

Des ouvrages pour les adultes et les plus jeunes, qui aident à découvrir et comprendre la culture sourde
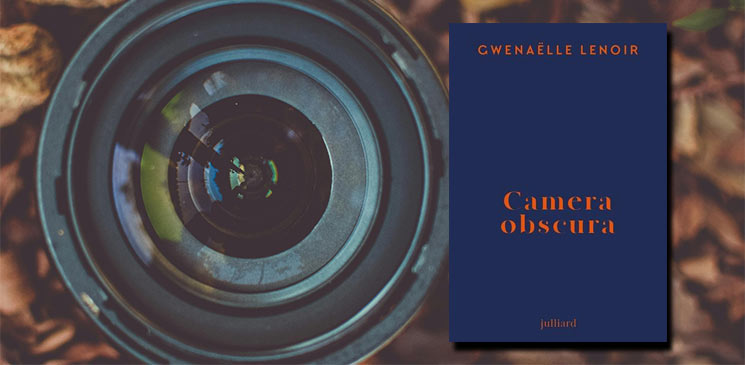
Notre héros, sous le nom de code "César", documente les tortures au péril de sa vie...
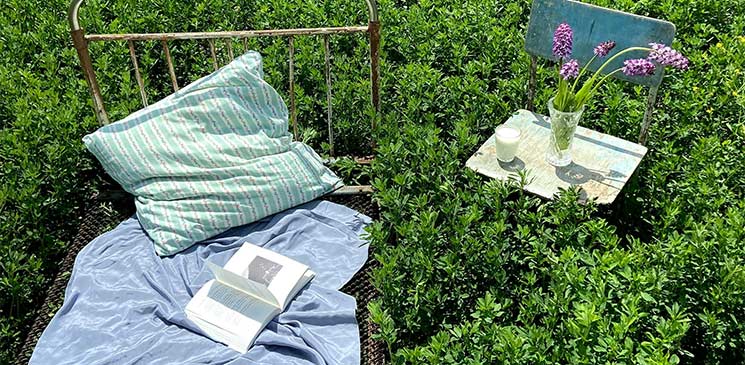
Tentez votre chance pour gagner un exemplaire du livre de votre choix !
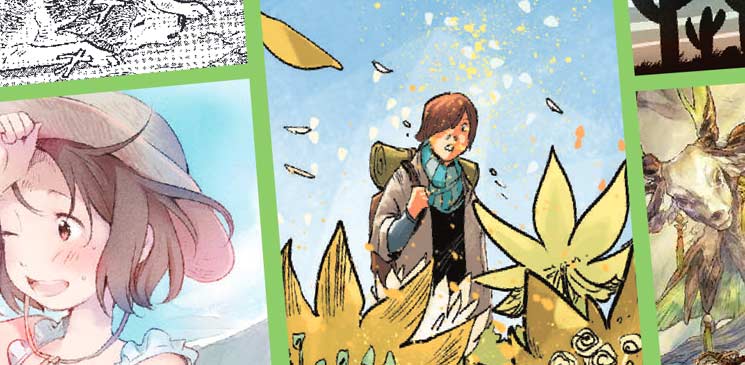
Avec la collection "La BD en classe", le Syndicat national de l’édition propose des supports pédagogiques autour de thématiques précises