
Nous avions eu la chance de rencontrer Grégoire Borst à l’occasion des 10 ans des Petits champions de la lecture, initiative soutenue par la Fondation Orange. A cette occasion, ce professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation (Paris) avait donné une conférence passionnante sur les processus permettant l’apprentissage de la lecture, que vous pouvez revoir ici.
Nous tenions absolument à échanger avec celui qui dirige également le Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Education de l’enfant (LaPsyDÉ - CNRS) afin qu’il nous éclaire sur ces mécanismes complexes et parfois difficiles, mais qu’il partage également ses pistes d’amélioration et ses conseils.
Nous sommes donc ravis de vous proposer aujourd’hui cet entretien avec Grégoire Borst qui, nous en sommes convaincus, vous aidera à comprendre les enjeux de l’apprentissage de la lecture pour les enfants, les ados, mais aussi les adultes.
Entretien avec Grégoire Borst : « Il ne faut pas opposer le numérique à la lecture »
- Pour commencer, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistent vos études ?
Les études que nous menons au laboratoire visent à essayer de comprendre deux choses. D’abord, comment se construisent les inégalités éducatives dans l’apprentissage du langage écrit, en mettant en évidence deux types de facteurs.
Il y a les facteurs propres au langage : on sait que les inégalités éducatives dans le domaine du langage écrit se construisent sur les inégalités éducatives dans le domaine du langage oral, et le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire et votre capacité de compréhension du langage oral vont être assez prédictifs de votre capacité à apprendre le langage écrit. C’est le premier grand domaine dans lequel on travaille, mais on travaille aussi sur des facteurs un peu plus transversaux qui ne sont pas impliqués dans l’apprentissage du langage oral et du langage écrit et qui sont des facteurs qu’on retrouve dans tout type d’apprentissage. Ce sont ce qu’on appelle des facteurs de haut niveau dans le cerveau humain qui relèvent par exemple des capacités attentionnelles ou des capacités de mémoire à court terme. On appelle cela la mémoire de travail, c’est-à-dire cette mémoire qu’on engage quand on doit retenir un certain nombre d’informations et les manipuler. Typiquement, au cours de la lecture d’un texte, il faut retenir le début de la phrase pour en comprendre l’ensemble.
Cela concerne aussi toutes les capacités permettant de faire fi des distracteurs visuels de ceux de notre environnement, afin d’être concentré sur ce qu’on est en train de lire. Tous ces processus-là participent aussi à l’apprentissage du langage écrit.
La question que l’on se pose au laboratoire, c’est le poids de ces différents facteurs dans l’apprentissage du langage écrit et comment on peut essayer de développer des interventions pour développer soit le langage oral, soit ces fonctions transverses du cerveau.
Il y a donc tout un champ du laboratoire qui vise à évaluer des interventions auprès d’enfants sur ces questions-là, dans le domaine du développement du vocabulaire ou dans celui des fonctions dont j’ai parlé ici, qu’on appelle « fonctions exécutives ». Ce sont celles qui régulent toutes les autres fonctions cognitives de notre cerveau et les fonctions attentionnelles.
Donc il peut s’agir de favoriser la lecture parentale et la lecture à haute voix, car on sait que tout cela participe au développement des capacités langagières de l’enfant. Et il y a donc un autre champ, qui est d’essayer de développer les capacités attentionnelles et les fonctions exécutives, plutôt avec des jeux vidéo. On joue donc sur les deux types de fonctions en même temps et on n’oppose pas le numérique à la lecture. Il y a des interventions qui sont très « lecture » mais on peut aussi jouer avec le jeu vidéo pour développer ce type de compétences-là. Et ce que nous montrons, c’est que cela se transfère aux capacités de lecture.
- Très concrètement, pouvez-vous décrire le processus qui permet à notre cerveau d’apprendre à lire ? Ce qui peut nous sembler évident quand on maîtrise la lecture ne relève pas de quelque chose de naturel au premier abord…
Ce qu’apprend à faire un cerveau qui apprend à lire, c’est à faire communiquer des zones qui, à la naissance en tout cas, ne communiquent pas de façon préférentielle.
Il y a bien sûr les aires qui sont plutôt impliquées dans le langage. On voit bien pourquoi c’est important dans l’apprentissage du langage écrit : il faut que je puisse prononcer les mots pour reconnaître ces mots et accéder à leur sens. Mais évidemment en amont de cela, il y a ma capacité à faire un traitement visuel des lettres écrites. Donc tout l’enjeu de l’apprentissage de la lecture consiste à faire communiquer ces deux grandes régions du cerveau, ces deux grands réseaux de neurones. C’est par l’apprentissage de la lecture qu’on apprend à ces deux grandes régions à communiquer ensemble.
En fait, ce sont les premières étapes de l’apprentissage de la lecture, c’est-à-dire l’appariement entre les phonèmes [NDLR : un phonème est un élément sonore du langage articulé] et les graphèmes [NDLR : un graphème est une unité graphique du langage écrit, destinée transcrire le phonème.
Autrement dit, associer les sons de la langue à la façon dont ils s’écrivent. Pour y parvenir, il faut décoder visuellement les mots, les syllabes (les graphèmes, donc), et les associer à des phonèmes. Au cours de l’apprentissage de la lecture, plus notre cerveau développe une expertise visuelle dans la reconnaissance des lettres, plus il va spécialiser certaines régions, notamment dans les aires postérieures du cerveau, dans l’hémisphère gauche. C’est ce qu’on appelle l’aire de la forme visuelle des mots et des lettres.
« Dans les milieux sociaux moins favorisés,
il y a en moyenne sept fois plus d’enfants faibles lecteurs »
- Pourquoi est-ce plus compliqué pour certains que pour d’autres, et comment fait-on pour les aider ?
Il faut dissocier deux types de difficultés. Il y a des enfants dont on sait qu’ils ont un trouble du neurodéveloppement, notamment la dyslexie. La dyslexie la plus courante dans la population générale est la dyslexie d’ordre phonologique, c’est-à-dire la difficulté à segmenter les phonèmes. Les enfants dyslexiques ont donc du mal à associer graphèmes et phonèmes. Il y a d’autres types de dyslexie, par exemple plus attentionnelles, mais là on revient à ce que je vous disais tout à l’heure, avec ces deux types de processus, langagiers et transversaux.
Le cerveau de ces enfants va se développer un peu différemment. Par exemple, l’aire de la forme visuelle des mots ne s’active pas aussi fortement chez ces enfants que chez des enfants « normo-lecteurs » , c’est-à-dire des enfants qui peuvent avoir des compétences variables en lecture mais n’ont pas de troubles du neurodéveloppement. On sait aussi que ce sont des enfants chez qui certaines régions impliquées dans le langage vont être un peu différentes en termes de structure. Certains liens entre certaines régions du cerveau, certaines aires impliquées dans le langage, vont être différents chez ces enfants. Pour ces enfants, ce sont des petites différences au début, mais comme la lecture est un entraînement, si vous avez des difficultés au début de l’apprentissage de la lecture parce que vous avez du mal à associer graphèmes et phonèmes, des phénomènes d’amplification vont se mettre en place : comme vous avez du mal à lire beaucoup de mots, vous allez en lire moins, et comme vous en lisez moins, vous vous auto-entraînez moins. Ces enfants ont donc une « pathologie de la lecture ».
Et puis, il y a les enfants « tout-venant » d’une certaine manière, qui peuvent avoir des compétences variables en lecture, en raison de divers facteurs. Cela peut être lié au nombre de mots dans le vocabulaire de l’enfant au moment où il commence à apprendre à lire. Si j’ai beaucoup de mots dans mon vocabulaire, à chaque fois que je vais associer un graphème et un phonème, je vais pouvoir articuler le mot et accéder à son sens. Si j’ai très peu de mots dans mon vocabulaire, il y a un double travail à faire : non seulement il faut que je reconnaisse le mot mais aussi que je comprenne son sens. En termes de ressources, c’est beaucoup plus coûteux. Par ailleurs, il y a des différences en matière de compétences attentionnelles, qui vont jouer sur les capacités de lecture. Au bout du processus, être un expert dans la lecture, ce n’est pas simplement décoder les mots, c’est accéder au sens du texte. Là, on voit bien que des compétences attentionnelles différenciées, des compétences en matière de fonctions exécutives, peuvent aussi expliquer des différences en termes de compétences de lecture.
On sait que dans les milieux sociaux moins favorisés, il y a en moyenne sept fois plus d’enfants faibles lecteurs, en raison de multiples facteurs et notamment de moins bonnes compétences de langage oral, ce qui va construire ensuite des inégalités dans l’apprentissage du langage écrit.
- Ce que vous appelez « un enfant faible lecteur », cela se définit à la fois d’un point de vue quantitatif, mais aussi par rapport à la fluidité et à la compréhension du texte ?
Absolument, c’est un ensemble de facteurs. Il y a le décodage, la fluidité, c’est-à-dire le nombre de mots qu’ils peuvent lire par minute, mais c’est aussi une évaluation de la compréhension du texte. Car in fine, ce qui nous intéresse, c’est quand même l’accès au sens. Le décodage n’est qu’un prétexte pour accéder au sens.
Si vous ne décodez pas très bien, si ce n’est pas très automatisé, vous êtes obligé d’engager énormément de ressources cognitives pour décoder les mots et vous ne pouvez pas les allouer à la compréhension du texte. C’est donc un jeu de vases communicants.
- Comment aide-t-on les enfants dyslexiques dans leur apprentissage de la lecture ? S'agit-il de mettre en place avec eux des stratégies différentes, adaptées à leur profil, tenant à la fois compte de leurs difficultés mais aussi de leurs atouts ?
Oui, c’est ce qu’on appelle des stratégies de remédiation. Ces enfants auront toujours un cerveau dyslexique car c’est le propre d’un trouble neurodéveloppemental : vous restez dyslexique, on ne peut pas mettre sa dyslexie en pause. Parfois, on entend ce genre de discours qui vise à promouvoir une certaine forme d’inclusivité, mais il faut bien comprendre que quand on est dys, on l’est tout le temps. En revanche, on peut mettre en place des stratégies qui permettent de contourner le trouble, de trouver d’autres façons de faire les choses.
Par exemple, on peut essayer de renforcer les capacités attentionnelles : si j’ai plus de ressources cognitives attentionnelles, cela peut parfois compenser les difficultés dans le domaine phonologique. D’ailleurs, on travaille aussi sur des exercices permettant de développer les compétences phonologiques.
On essaie donc de trouver à la fois des interventions qui visent directement le trouble spécifique observé dans la dyslexie, mais aussi parfois des stratégies de contournement. Une des pistes actuelles consiste à viser des processus de très haut niveau, avec l’idée qu’en cascade, cela permette une meilleure gestion des ressources cognitives. C’est une façon de les « armer » pour pouvoir faire du décodage plus efficace.
« Il faut inscrire dans la culture d’un élève
l’idée qu’un texte, ça peut se dire »
- Du point de vue d’un neuroscientifique, y a-t-il des spécificités de la lecture à voix haute ? Qu’apporte-t-elle ?
En fait, il faut dissocier deux choses. D’abord, la lecture à voix haute est assez similaire en termes de réseaux qu’elle va engager, quand on s’intéresse à l’accès au sens : les réseaux neuronaux qui permettent l’accès au sens sont relativement similaires, qu’il s’agisse de lecture à voix basse ou haute. Mais ce qu’amène la lecture à voix haute, c’est une aide à la compréhension du texte.
En effet, quand j’utilise la prosodie [NDLR : la prosodie consiste à intégrer l’accentuation et l’intonation], je fais passer du sens. Si je sais placer la bonne prosodie, c’est-à-dire la musique de la langue et du texte, si le texte devient du langage oral, je vais utiliser des intonations différentes. Par exemple, en fin de phrase, la prosodie d’une phrase interrogative n’est pas la même que celle d’une phrase déclarative. Tout cela aide à la compréhension du texte, donc cet enjeu de la lecture à voix haute consiste à permettre à certains élèves de recevoir une aide : en apprenant à mettre la bonne intonation à haute voix, j’accède au sens.
Ainsi, c’est plutôt sur l’accès au sens que la lecture à voix haute joue, mais cela fonctionne même si vous « imaginez » cette prosodie. En réalité, il s’agit d’inscrire dans la culture d’un élève l’idée qu’un texte, ça peut se dire. Et quand cela « se dit », cela devient du langage oral, et si c’est du langage oral, alors je peux me reposer sur mes compétences de langage oral.

Raphaël, petit champion de la lecture 2021. Photo © Frédéric Berthet
- C’est donc une façon pour l’élève de s’approprier le texte qui lui est présenté ?
Oui, il devient le sien et le renvoie à la façon dont on parle dans la vie réelle, à la façon dont on communique. Si je dis le texte, cela m’aide à le segmenter, à percevoir les graphèmes et les phonèmes.
Tout cela participe au décodage et à l’accès au sens.
- Lorsqu’elle est travaillée dans le cadre d’un projet scolaire, la lecture à voix haute permet-elle le développement d’éléments un peu plus subjectifs, comme le plaisir de lire ou la confiance en soi ?
Ce n’est pas tant la lecture à voix haute en tant que telle, mais le fait qu’il s’agisse effectivement d’un projet pédagogique autour d’un texte, travaillé avec les enfants. Apprendre à dire ce texte à haute voix, à placer l’intonation, faire vivre le texte, cela permet à l’enfant de passer du « lire » au « dire ». Il arrive ainsi à prendre du plaisir à dire le texte et à ne plus être dans la difficulté du décodage. C’est donc une façon d’associer du plaisir aux apprentissages et dès lors, on jour sur la motivation intrinsèque de l’élève. Une fois qu’il a vu qu’il était capable, l’enfant peut avoir la motivation interne de continuer à s’engager dans ces apprentissages. Evidemment, ensuite, en corollaire, cela va développer l’estime de soi, mais il faut bien comprendre que cela fonctionne plutôt toujours dans ce sens-là.
Ce que je veux dire, c’est que jouer sur l’estime de soi en pensant que cela améliore les compétences scolaires, ça ne marche pas. Il faut trouver une situation pédagogique pour pouvoir motiver l’enfant, l’amener à se dépasser, à être persévérant, à réussir dans des situations qui pouvaient être délicates pour lui. A ce moment-là, oui, on réengage le plaisir d’apprendre qui joue sur la motivation intrinsèque de l’enfant, et c’est bien cela qu’on vise.
Quand les enfants sont très jeunes, ce sont des machines à apprendre car ils ont un plaisir fou à le faire. Après, cela devient plus difficile et notre système éducatif n’est pas totalement construit pour maximiser des retours positifs autour des apprentissages. Tout cela peut donc avoir des effets négatifs sur les apprentissages des élèves et notamment ceux qui sont en difficulté. Dès lors que vous êtes en difficulté, les retours qu’on vous fait sont plutôt négatifs…
- Quand vous parlez de cet « après », de ce moment où cela se complique, à quel âge cela correspond-il ? A l’entrée au collège ?
Non, dès l’entrée au CP. En fait, l’apprentissage de la lecture est difficile car on saisit mal qu’il puisse y avoir des trajectoires d’apprentissage très différentes d’un enfant à un autre, ne serait-ce que parce qu’on vient d’un milieu social différent, d’une famille allophone, parce que vous êtes de la fin de l’année et pas du début… Tout cela joue sur les inégalités éducatives.
Par ailleurs, il y a des attendus très forts sur l’apprentissage de la lecture dès la fin du CP alors qu’on sait qu’il faudrait prendre des perspectives plutôt en fin de CE1 voire en début de CE2.
Après, il y a l’évaluation au collège qui effectivement « en remet une deuxième couche ». Quand on n’est plus sur l’évaluation des compétences mais l’évaluation sommative avec la note, c’est encore plus difficile. Si vous êtes bon élève, vous avez des renforcements positifs constants, mais si vous êtes mauvais élève, ce sont des renforcements négatifs constants.

- Le passage en sixième vient donc entériner des difficultés apparues bien plus tôt ?
En règle générale, on sait que le fait de ne pas avoir de compétences de lecture consolidées, de ne pas avoir l’expertise du décodage, comme de ne pas avoir automatisé l’écriture ou certaines compétences mathématiques, entraîne des inégalités éducatives au collège. On le voit bien, même en termes de bien-être des élèves, il y a un énorme décalage entre la fin du CM2 et l’entrée au collège. Plus tard, cela se résorbe, mais ce passage est difficile car il s’agit d’une autre façon de travailler. On est toujours dans un « groupe-classe », mais il faut aller de classe en classe, on a plusieurs professeurs, on est beaucoup plus disciplinaire…
- En quoi le niveau socio-économique de la famille influe-t-il généralement sur la capacité d’apprentissage de la lecture ?
Evidemment, nous parlons toujours de « moyennes » et il y a des familles qui sont très particulières. Mais en moyenne, donc, la difficulté liée au milieu social d’origine s’exprime par un environnement différent de celui de milieux plus favorisés, à commencer par la maison. Quand il y a des contraintes fortes sur le logement, il y a le risque que l’enfant ne puisse pas dormir dans une pièce séparée de ses parents et/ou de ses frères et sœurs, ce qui créent des contraintes sur le sommeil. On sait que le sommeil est extrêmement important pour les apprentissages, la mémorisation et la plasticité cérébrale et souvent, ces enfants ont des déficits de sommeil.
On sait également que ce sont des enfants qui, en règle générale, du fait de l’environnement familial et de la pression sur l’emploi (parfois avec des rythmes de travail décalés), sont davantage soumis à du stress chronique, ce qui a aussi des effets sur le développement cérébral. Dans un milieu défavorisé, dès 4 mois, le cerveau se développe un peu différemment, notamment dans des régions importantes pour les apprentissages, liées à la mémorisation, à la réactivité émotionnelle et au langage.
Un milieu social défavorisé – même si encore une fois, cela peut être différent d’une famille à une autre – c’est aussi un milieu dans lequel la richesse cognitive va être un peu moins importante. Il y aura moins de livres à la maison, moins de temps pour faire la lecture parentale, moins d’interactions entre les enfants et les adultes. Tout cela constitue l’ensemble d’un environnement qui est plus ou moins propice pour le développement langagier. Développer son langage, c’est être en interaction avec ses parents, mais il faut qu’ils aient suffisamment de temps pour jouer et communiquer avec leurs enfants…
Et puis parfois, se rajoute la problématique des familles allophones, c’est-à-dire qu’on demande aux enfants d’apprendre à lire dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle. Ce n’est pas un problème dans les milieux allophones où les familles communiquent beaucoup avec l’enfant car l'enfant développe un vocabulaire même si ce n’est pas dans la langue dans laquelle il apprend à lire. Le fait qu’il ait énormément de mots dans son vocabulaire lui permet de rattraper son retard. Mais dans d’autres cas, ces multiples facteurs vont s’additionner. Vous êtes dans un milieu social défavorisé, dans une famille allophone et tout cela va jouer sur le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire.
Il faut bien prendre conscience que tout cela se construit dès l’entrée en maternelle. Si on regarde le nombre de mots que des enfants venant de milieux sociaux défavorisés ont dans leur vocabulaire, on voit qu’il y a un rapport de 1 à 2 voire 2,5 par rapport aux enfants de milieux plus favorisés. On sait que c’est très prédictif de la façon dont se déroulera l’apprentissage de la lecture et on a ensuite une cascade : vous avez moins de mots dans votre vocabulaire, vous allez moins bien apprendre le langage écrit, et comme vous apprenez moins bien le langage écrit, cela aura d’autres effets.
Cela ne concerne pas seulement le domaine du français, puisque cela affecte votre compréhension d’un problème arithmétique, d’un texte en sciences et ainsi de suite. Cela crée des inégalités éducatives qui vont se renforcer au fil du temps.
« Oui, ils lisent davantage de mangas, mais ils lisent !
Et tout l'enjeu est là. »
- Sur ce point, vous aviez expliqué lors de votre conférence que contrairement à certaines craintes, le numérique ne transforme pas le cerveau. Bien au contraire, vous teniez à ne pas opposer le numérique à la lecture mais plutôt à trouver des passerelles et des complémentarités. Comment liez-vous les deux, et comment est la lecture en 2022 ?
Ce qui est sûr, c’est que la lecture en 2022 est différente de ce qu’elle était en 2002 ou en 1992 car le poids du numérique a fortement varié. Mais force est de constater qu’on lit beaucoup sur le numérique !
On est très souvent en mode lecture et décodage, on écrit des mails, on lit des articles, on lit des commentaires sur des vidéos… Même quand on est sur les plateformes plutôt plébiscitées par les jeunes comme TikTok ou Instagram, il y a quand même du texte. Sur YouTube, évidemment il y en a un peu moins, mais sur Snapchat, il y a aussi des communications en texte, c’est le cas aussi sur Whatsapp… C’est un écrit différent, mais il y a de l’exposition à l’écrit.
La deuxième chose qu’on entend, c’est « ils passent énormément de temps sur les écrans, donc ils ne lisent pas ». Les dernières études menées pendant le confinement montrent effectivement qu’il y a eu une consommation des écrans beaucoup plus importante qu’avant - de l’ordre de plus de 3 heures par jour pour un certain nombre d’adolescents notamment – mais cela n’a pas diminué le temps de lecture. Cela l’a même augmenté dans certains cas.
Alors oui, ils ne lisent pas de grands romans. Dont acte. Oui, ils lisent davantage de mangas. Mais ils lisent ! Et tout l’enjeu, c’est qu’ils lisent. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut éviter de caricaturer les choses en disant qu’il y a d’un côté la lecture papier qu’il faut sanctuariser et de l’autre le numérique qui viendrait forcément aspirer le temps de lecture. Ce n’est pas tout à fait ce qu’on observe. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer à promouvoir la lecture et montrer quel peut être le plaisir de la lecture, et on sait aussi qu’il y a des particularités liées au livre : quand on lit un texte sur un livre, on retient un peu plus d’informations, mais encore une fois, tout dépend du type de texte.
Sur le numérique, s’il y a des liens hypertextes qui permettent d’aller chercher de l’information, alors on a des effets différenciés. Si on utilise le numérique pour ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire présenter des PDF, ça n’a aucun intérêt. Mais si vous créez de l’interactivité, alors vous pouvez avoir des effets positifs sur la compréhension du texte.
- Nous avons beaucoup parlé des plus jeunes, mais comment procède-t-on quand il s’agit par exemple de jeunes adultes en difficulté avec la lecture ? La « plasticité » dont vous parliez n’est sans doute pas la même, mais les mécaniques sont-elles similaires ?
Il n’y a pas d’impossibilité à apprendre la lecture, même tardivement. Cela demande effectivement plus d’efforts car le cerveau est moins plastique, mais il l’est toujours et il y a toujours des reconfigurations possibles. Cela étant dit, on sait aussi que la façon dont va se structurer leur cerveau n’est pas exactement la même que pour des lecteurs ayant appris précocement. De plus, en termes d’années d’expertise, si vous avez appris à lire à 6 ans, vous gardez cet avantage à 30 ans : vous aurez 24 ans d’expérience contre 10 pour quelqu’un qui aurait appris à 20 ans. Evidemment, cela reste aussi dépendant de la fréquence à laquelle vous lisez.
Cet apprentissage va prendre du temps, mais les ressorts sont les mêmes : on peut toujours apprendre l’association graphèmes/phonèmes. Ensuite, il pourra y avoir un mécanisme d’auto-apprentissage pour ces adultes aussi, et il faut trouver un moyen pour les raccrocher à la lecture et qu’elle redevienne un plaisir, car ce sont souvent des gens qui ont eu un rapport difficile à la lecture.
- La problématique reste donc la même que pour les plus jeunes : donner du sens et développer une notion de lecture-plaisir ?
Oui, il y a le plaisir de lecture bien sûr. Mais il faut insister sur le « pourquoi » de la lecture, peut-être encore plus qu’avec les enfants (même s’ils en ont besoin aussi), c’est-à-dire travailler avec les apprenants sur les enjeux de cet apprentissage. Je crois que cela consitue des implicites forts : il faut expliquer pourquoi c’est important d’apprendre à lire, ce que ça produit et aussi, bien sûr, l’objectif final. C’est quand même quelque chose de fabuleux de passer d’un monde où il y a en quelque sorte des hiéroglyphes partout autour de nous (je caricature, bien sûr) qui, tout d’un coup, prennent sens. Notre quotidien devient complètement différent.
On ne s’en rend même plus compte en tant que lecteur expert, mais quand on passe notre vie dans des environnements où il y a du texte partout, tout le sens y est associé. Pour des lecteurs non-experts, en apprentissage, ou des illettrés, le monde est beaucoup plus complexe : tous les signes qui permettent de naviguer dans notre environnement sont absents. Tout ça, ce sont des facteurs de motivation.
« Il faut expliquer à un enfant
qu'il n’est pas condamné à être bon ou mauvais lecteur. »
- On imagine qu’il n’y a pas de recette miracle pour aider un enfant en difficulté avec la lecture (vous l’auriez déjà partagée !) néanmoins auriez-vous des pistes, des conseils pour des parents ou des grands-parents d’enfants confrontés à ce problème ?
Pour commencer, il y a un véritable enjeu à la lecture parentale, à la lecture avec un adulte. C’est quelque chose qu’il faut mettre en place tôt avec les enfants car c’est une façon de développer leur vocabulaire et de rentrer aussi dans la lecture. Ils voient quelqu’un d’autre lire et on sait qu’on apprend aussi par imitation.
La deuxième chose, c’est de maintenir cette lecture parentale même quand les enfants commencent à apprendre à lire, et la continuer relativement tardivement. On l’oublie un peu, mais le début de l’apprentissage de la lecture est tellement difficile que si en plus, on arrête de leur raconter des histoires, c’est un peu la double peine ! Cela devient presque une sanction : « Tu apprends à lire ? J’arrête de te lire des livres ! ». Je ne dis pas que les gens font exactement cela, mais il faut être extrêmement vigilant.
Pour des familles qui ont plus de difficultés avec la lecture, car certains parents sont illettrés ou peuvent avoir des difficultés à lire et décoder, il faut préciser que le simple fait de raconter des histoires aux enfants est important. Il y a des cultures qui sont plus centrées sur l’oralité et passer par l’oralité, c’est aussi une façon de développer le vocabulaire de l’enfant, de lui montrer comment on peut jouer avec la langue et les mots.
Ensuite, il y a un nécessaire accompagnement de cet apprentissage-là, comme de tous les autres, sur les enjeux à court, moyen et long terme. Il faut aussi expliquer ce qui va se passer : dire qu’un cerveau se transforme toute sa vie, c’est aussi une façon d’expliquer à un enfant qu’il n’est pas condamné à être bon ou mauvais lecteur. C’est aussi une façon de promouvoir auprès de ces enfants un état d’esprit de changement dans ses apprentissages : il n’est pas condamné à être bon ou mauvais élève puisque s’il s’entraîne, pratique, apprend, il va transformer son cerveau.
Il faut aussi lui annoncer quelles sont les étapes : il y a des étapes un peu difficiles où on associe les sons de la langue à la façon dont ils sont écrits, puis on va reconnaître le mot puis la globalité et ensuite, cela va devenir plus facile mais évidemment, pour tout cela, il faut s’entraîner. Ils le font très bien dans un jeu vidéo : au départ, ils ne savent pas jouer à un jeu, mais ils persévèrent car c’est ludique et cela procure une certaine forme de plaisir donc ils débloquent des compétences. Il faut aussi faire des parallèles, comparer aux autres apprentissages : certes, c’est moins ludique au début mais lui expliquer « après, tu feras du sens de tout ce qu’il y a autour de toi, tu vas pouvoir lire par toi-même, te faire ta propre opinion sur les choses… » Il faut prendre ce temps-là aussi.
- Pour finir, pouvez-vous nous parler du titre Dans la tête de mon ado écrit avec Soledad Bravi et Agathe de Lastic (Vents d'ouest), auquel vous venez de contribuer ? Comment avez-vous été amené à travailler sur ce projet et quel a été votre rôle ?
J’y ai participé car je pense qu’il est fondamental que les parents puissent comprendre ce qu’est réellement l’adolescence. Ils n’ont pas forcément beaucoup d’informations sur ce qu’est un adolescent, donc on rentre ici dans sa tête pour comprendre sa propre perspective sur le monde. Souvent, nous avons un peu oublié quel adolescent nous étions, et nous avons un regard que je trouve assez dur envers les adolescents.
Il y a un enjeu à avoir un regard bienveillant vis-à-vis de ces ados qui sont un peu différents de nous, mais ne sont pas du tout aussi irrationnels qu’on le pense. L’idée est d’ouvrir un peu le champ des connaissances des parents sur leurs enfants, mais il y a évidemment aussi un côté humoristique car c’est Soledad Bravi qui a dessiné ce titre. J’ai volontairement refusé d’être « auteur » sur ce titre, car le projet était déjà à un degré de maturation important quand l’auteure est venue me voir. J’ai plutôt participé à la réécriture de certains textes, pour m’assurer de la validité scientifique des parties écrites.
Par ailleurs, cela correspond aussi une réflexion plus globale que j’ai. Ce livre, Dans la tête de mon ado en appelle un autre qui va sortir le 15 août et qui s’appelle C’est (pas) moi, c’est mon cerveau (ed. Nathan) qui est un livre destiné aux adolescents, sur leur cerveau. C’est un livre extrêmement complet, qui balaie très large en expliquant la puberté du cerveau, mais aussi les problématiques d’amitié, d’amour, ou encore les prises de risques, la question du groupe sociale, de la créativité, de la prise de décision. Il pose aussi la question « comment arrive-ton à préserver son cerveau quand on est un adolescent ? ». On sait que l’exposition aux drogues et à l’alcool est un vrai fléau pour le cerveau adolescent.
Ce qu’on a essayé de faire avec ce livre, c’est d’avoir à chaque fois une mise en situation, où on va jusqu’à faire du langage ado, avec du Whatsapp, etc. On aborde le thème et ensuite on est très scientifique, on leur parle comme à des ados capables de raisonnement, de compréhension de phénomènes complexes et on leur explique tout cela en relation avec leur cerveau qui est en maturation. A la fin, des quizz sont proposés, mais ils ne sont pas là uniquement pour s’amuser. L’idée est de savoir, en tant qu’ado, ce que je peux faire, si par exemple j’ai des difficultés vis-à-vis de l’alcool ou du cannabis, si je suis sujet au mal-être, il y a aussi des focus sur l’importance du sommeil, etc. Cela vise une prise de conscience, afin d’éviter d’être dans une communication trop verticale. J’ai écrit cela avec mon collègue, Matthieu Cassotti et il y a aussi des petits tests sur la créativité, que les ados peuvent tester sur leurs parents, leurs copains… On a aussi un volet sur les fake news ou les théories du complot, qui là aussi peuvent permettre de tester d’autres personnes.
C’est un livre qui se veut le plus interactif possible et qui va servir aux ados, mais où les parents apprendront largement autant de choses qu’eux sur ce qu’est cerveau en développement.
Tout ceci est donc pensé dans le cadre d’une réflexion plus globale qui est de travailler sur les trois piliers de la co-éducation. On a le livre pour les parents qui est Dans la tête de mon ado, celui pour les ados C’est pas moi, c’est mon cerveau et on a sorti aussi chez Nathan un livre pour les enseignants qui s’appelle Enseigner aux élèves : comment apprendre, qui explicitera tous les processus dont nous avons parlé dans cet entretien. Ce ne sont pas spécifiquement ceux engagés dans la lecture, mais tous les processus transversaux : comment fonctionnent la concentration, les émotions, pourquoi la situation d’apprentissage est aussi une situation d’émotions…
L’adolescence est une période particulière pour les apprentissages, une période particulière de notre vie tout court, et on a vraiment besoin que tout le monde ait des connaissances partagées de ce point de vue-là.
Propos recueillis par Nicolas Zwirn



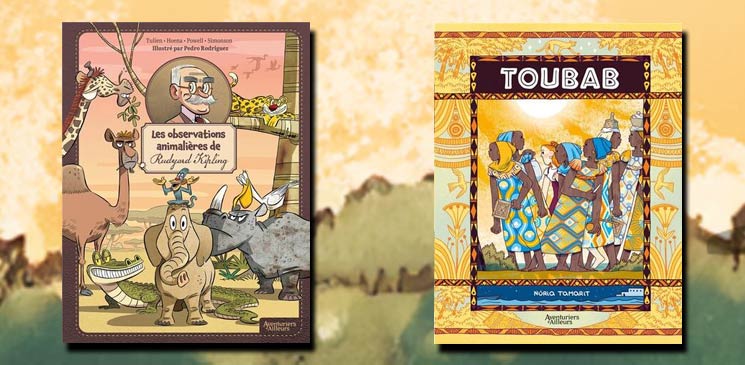

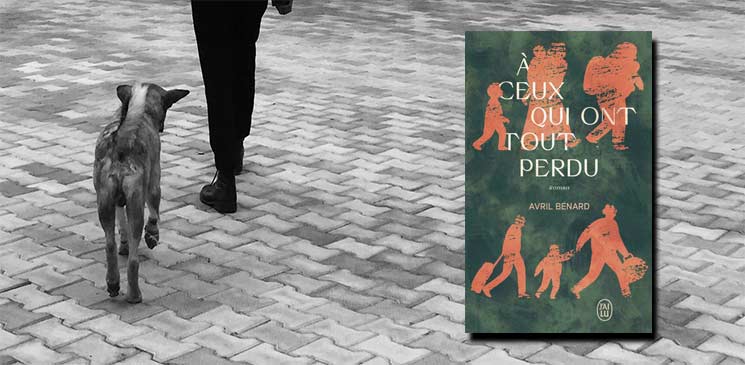













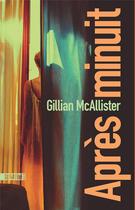

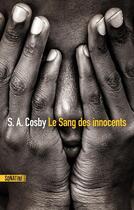
Un article vraiment très intéressant !
C est vrai se qu ils dit c est se qu on m'a dit les professeurs pour mon enfant ,il faut lui
faire découvrir la lecture les bienfaits ,les sujets divers , lire à haute voix ,débloquer ses compétences, c est très important pour lui plus tard